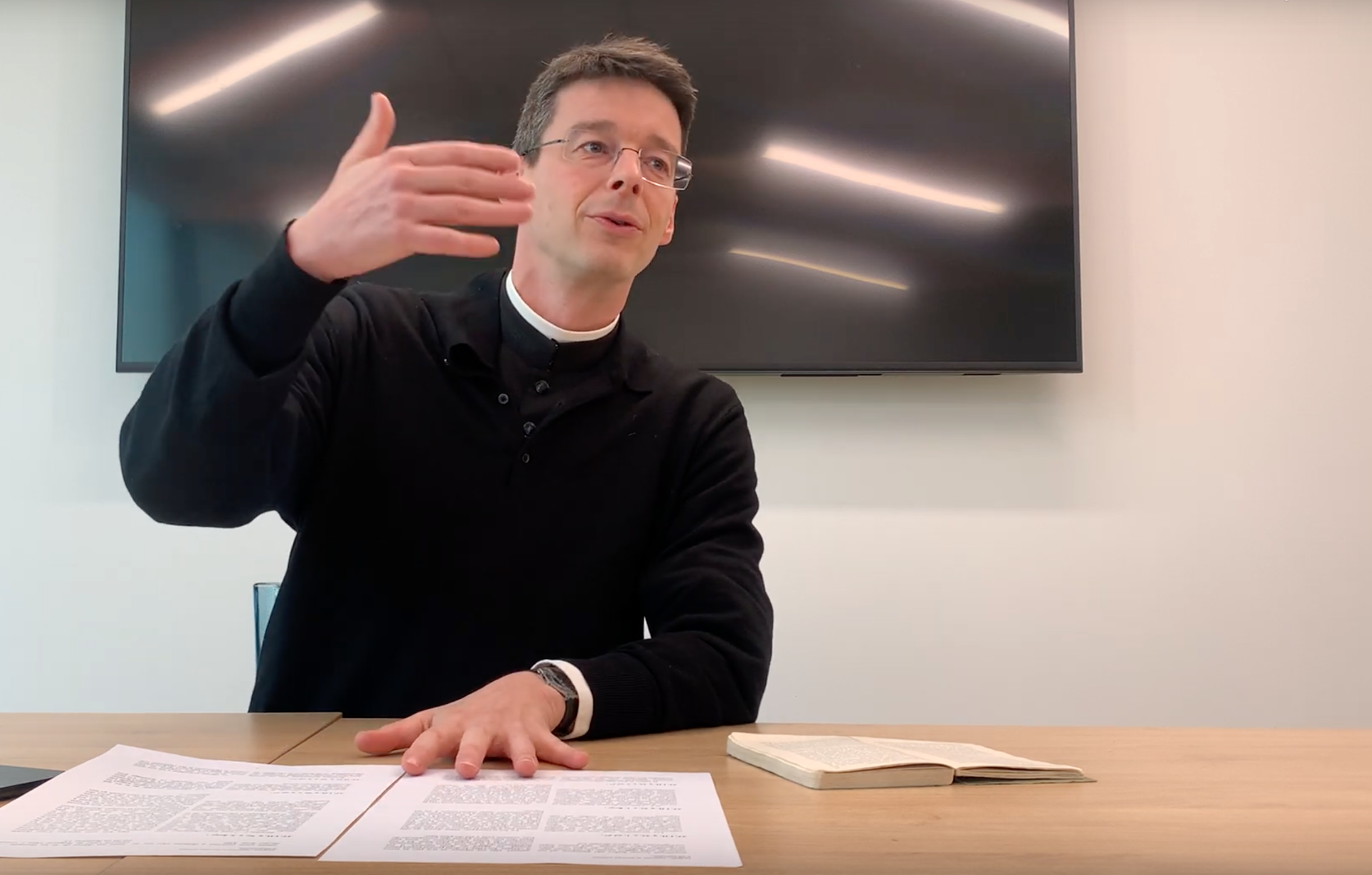CONFÉRENCE
Une contribution suprenante et toute en finesse sur l’enjeu de l’obéissance à la loi… La video de la séquence de laboratoir et de controverse suit dessous ces textes
CI DESSOUS – Textes en référence au contenu de l’intervention
Summa Theologiae [ST], I-II, q. 95, a. 2, Resp. :
| Sicut Augustinus dicit, in I de Lib. Arb., « non videtur esse lex, quae iusta non fuerit ». Unde inquantum habet de iustitia, intantum habet de virtute legis. In rebus autem humanis dicitur esse aliquid iustum ex eo quod est rectum secundum regulam rationis. Rationis autem prima regula est lex naturae, ut ex supradictis patet. Unde omnis lex humanitus posita intantum habet de ratione legis, inquantum a lege naturae derivatur. Si vero in aliquo, a lege naturali discordet, iam non erit lex sed legis corruptio. | Comme Augustin le dit dans le livre I du De libero arbitrio, « elle ne semble pas être une loi, celle qui ne serait pas juste » [1]. C’est pourquoi une loi a autant « force de loi » qu’elle a de justice. Or, dans les choses humaines, quelque chose est dit être juste du fait qu’il est droit selon la règle de la raison. Or la première règle de la raison est la loi de nature, comme cela ressort clairement de ce qui a été dit supra. De là vient que toute loi humainement établie n’a raison de loi qu’autant qu’elle dérive de la loi de nature. Mais si elle s’écartait en quoi que ce soit de la loi naturelle, elle ne serait déjà plus une loi, mais une corruption de loi[2]. |
ST, I-II, q. 93, a. 3, ad 2m :
| Lex humana intantum habet rationem legis, inquantum est secundum rationem rectam, et secundum hoc manifestum est quod a lege aeterna derivatur. Inquantum vero a ratione recedit, sic dicitur lex iniqua, et sic non habet rationem legis, sed magis violentiae cuiusdam. | Une loi humaine a “raison” de loi pour autant qu’elle est selon la raison droite, et, d’après cela, il est manifeste qu’elle est dérivée de la loi éternelle. Mais en tant qu’elle s’écarte de la raison, on dit d’elle que c’est une loi inique, et, ainsi, elle n’a pas “raison” de loi, mais plutôt raison d’une sorte de violence. |
ST, II-II, q. 60, a. 5, ad 1m :
| Lex scripta, sicut non dat robur iuri naturali, ita nec potest eius robur minuere vel auferre, quia nec voluntas hominis potest immutare naturam. Et ideo si Scriptura legis contineat aliquid contra ius naturale, iniusta est, nec habet vim obligandi, ibi enim ius positivum locum habet ubi quantum ad ius naturale nihil differt utrum sic vel aliter fiat, sicut supra habitum est. Et ideo nec tales Scripturae leges dicuntur, sed potius legis corruptiones, ut supra dictum est. | La loi écrite, de même qu’elle ne donne pas force (de loi) au droit naturel, ne peut pas non plus la diminuer ou l’enlever, car la volonté de l’homme ne peut changer la nature. Et c’est pourquoi si la loi écrite contient quelque chose qui va contre le droit naturel, elle est injuste, et n’a pas la force d’obliger. En effet, le droit positif prend place quand, eu égard au droit naturel, il est indifférent qu’il en soit ainsi ou autrement, comme cela a été acquis plus haut. Et c’est pourquoi de telles lois écrites ne sont pas dites des lois, mais plutôt des corruptions de lois, comme cela a été dit plus haut. |
ST, I-II, q. 92, a. 1, ad 4m :
| Lex tyrannica, cum non sit secundum rationem, non est simpliciter lex, sed magis est quaedam perversitas legis. Et tamen inquantum habet aliquid de ratione legis, intendit ad hoc quod cives sint boni. Non enim habet de ratione legis nisi secundum hoc quod est dictamen alicuius praesidentis in subditis, et ad hoc tendit ut subditi legi sint bene obedientes ; quod est eos esse bonos, non simpliciter, sed in ordine ad tale regimen. | La loi tyrannique, étant donné qu’elle n’existe pas d’après la raison, n’est pas une loi au sens absolu, mais plus une forme de perversité de loi. Et cependant, en tant qu’elle a quelque chose de la « raison » de loi, elle tend à ce que les citoyens soient bons. En effet, elle ne détient, de la raison de loi, que le fait qu’elle est un commandement d’un chef à ses subordonnés, et elle tend à ce que ceux qui sont soumis à la loi soient bien obéissants, c’est-à-dire à les rendre bons, non pas absolument, mais relativement à un tel régime. |
ST, I-II, q. 92, a. 1, Resp.:
| Si […] intentio ferentis legem tendat in verum bonum, quod est bonum commune secundum iustitiam divinam regulatum, sequitur quod per legem homines fiant boni simpliciter. Si vero intentio legislatoris feratur ad id quod non est bonum simpliciter, sed utile vel delectabile sibi, vel repugnans iustitiae divinae; tunc lex non facit homines bonos simpliciter, sed secundum quid, scilicet in ordine ad tale regimen. Sic autem bonum invenitur etiam in per se malis, sicut aliquis dicitur bonus latro, quia operatur accommode ad finem. | Si l’intention du législateur tend vers le vrai bien, qui est le bien commun réglé suivant la justice divine, il s’ensuit que, par la loi, les hommes sont rendus bons au sens absolu. Mais si l’intention du législateur se porte vers ce qui n’est pas bon purement et simplement, mais ce qui est utile ou agréable, ou qui est contraire à la justice divine, alors la loi ne rend pas les hommes bons au sens absolu, mais relativement, c’est-à-dire en référence à tel régime. C’est ainsi que le bien se trouve même dans les maux en soi, comme lorsque quelqu’un est dit être un “bon voleur”, parce qu’il agit de manière appropriée à sa fin. |
ST, I-II, q. 93, a. 3, ad 2m :
| Et tamen in ipsa lege iniqua inquantum servatur aliquid de similitudine legis propter ordinem potestatis eius qui legem fert, secundum hoc etiam derivatur a lege aeterna, omnis enim potestas a domino Deo est, ut dicitur Rom. XIII. | Et cependant, dans la loi injuste elle-même, en tant qu’est conservé quelque chose de la similitude de la loi du fait de l’ordre du pouvoir qui fait la loi, dans cette mesure cela aussi est dérivé de la loi éternelle : « tout pouvoir vient du Seigneur Dieu », comme il est dit en Romains 13. |
ST, I-II, q. 96, a. 4, Resp. :
| Iniustae […] sunt leges dupliciter. Uno modo, per contrarietatem ad bonum humanum. […] Et huiusmodi magis sunt violentiae quam leges, quia, sicut Augustinus dicit, in libro de Lib. Arb., lex esse non videtur, quae iusta non fuerit. Unde tales leges non obligant in foro conscientiae, nisi forte propter vitandum scandalum vel turbationem, propter quod etiam homo iuri suo debet cedere, secundum illud Matth. V, qui angariaverit te mille passus, vade cum eo alia duo; et qui abstulerit tibi tunicam, da ei et pallium. Alio modo leges possunt esse iniustae per contrarietatem ad bonum divinum, sicut leges tyrannorum inducentes ad idololatriam, vel ad quodcumque aliud quod sit contra legem divinam. Et tales leges nullo modo licet observare, quia sicut dicitur Act. V, obedire oportet Deo magis quam hominibus. | Des lois sont injustes d’une double manière. De la première, par contradiction avec le bien humain. […] de telles lois sont plus des violences que des lois, car, comme Augustin le dit, dans le livre De libero arbitrio, « une loi ne semble pas être une loi qui ne serait pas juste ». De là vient que de telles lois n’obligent pas dans le for de la conscience, si ce n’est peut-être pour éviter le scandale ou le trouble, ce en raison de quoi l’homme doit céder son droit, selon ce qui est dit en Matthieu 5 : « Si quelqu’un te réquisitionne pour faire mille pas, accompagne-le encore deux mille pas ; et si quelqu’un te prend ta tunique, donne-lui aussi ton manteau ». D’une seconde manière des lois peuvent être injustes, par contradiction avec le bien divin, comme les lois des tyrans forçant à l’idolâtrie ou à toute autre chose qui soit contre la loi divine. Et de telles lois, il n’est permis en aucune manière de les observer, car, comme il dit au livre V des Actes des Apôtres, “il faut obéir à Dieu plutôt qu’aux hommes” ». |
ST, I-II, q. 96, a. 4, ad 3m :
| Ratio illa procedit de lege quae infert gravamen iniustum subditis, ad quod etiam ordo potestatis divinitus concessus non se extendit. Unde nec in talibus homo obligatur ut obediat legi, si sine scandalo vel maiori detrimento resistere possit. | Cet argument procède de la loi qui inflige un poids injuste aux sujets, auquel ne s’étend pas l’ordre du pouvoir concédé par Dieu. De là vient qu’en ces matières l’homme n’est pas obligé d’obéir à la loi, s’il peut résister sans scandale ou dommage plus grand. |
ST, II-II, q. 42, a. 2, ad 3m :
| Regimen tyrannicum non est iustum, quia non ordinatur ad bonum commune, sed ad bonum privatum regentis, ut patet per philosophum, in III Polit. et in VIII Ethic. Et ideo perturbatio huius regiminis non habet rationem seditionis, nisi forte quando sic inordinate perturbatur tyranni regimen quod multitudo subiecta maius detrimentum patitur ex perturbatione consequenti quam ex tyranni regimine. Magis autem tyrannus seditiosus est, qui in populo sibi subiecto discordias et seditiones nutrit, ut tutius dominari possit. Hoc enim tyrannicum est, cum sit ordinatum ad bonum proprium praesidentis cum multitudinis nocumento. | Le régime tyrannique n’est pas juste, parce qu’il n’est pas ordonné au bien commun, mais au bien privé du gouvernant, comme le Philosophe le fait clairement voir au livre III des Politiques et au livre VIII de l’Éthique à Nicomaque. Et c’est pourquoi le renversement de ce régime n’a pas « raison » de sédition, à moins, peut-être, que le régime du tyran soit perturbé dans un tel désordre que la multitude gouvernée subisse un dommage plus grand en conséquence du trouble que du fait du gouvernement du tyran. Or c’est plus le tyran qui est séditieux, lequel nourrit dans le peuple qui lui est soumis les discordes et les séditions, pour pouvoir dominer plus sûrement. En effet, cela est tyrannique, car c’est ordonné au bien propre de celui qui est à la tête du peuple, au détriment de la multitude. |
ST, I-II, q. 98, a. 1, Resp.:
| Est […] sciendum quod est alius finis legis humanae, et alius legis divinae. Legis enim humanae finis est temporalis tranquillitas civitatis, ad quem finem pervenit lex cohibendo exteriores actus, quantum ad illa mala quae possunt perturbare pacificum statum civitatis. Finis autem legis divinae est perducere hominem ad finem felicitatis aeternae; qui quidem finis impeditur per quodcumque peccatum, et non solum per actus exteriores, sed etiam per interiores. | Il faut savoir qu’autre est la finalité de la loi humaine, autre celle de la loi divine. En effet, la finalité de la loi humaine est la tranquillité temporelle de la cité, fin à laquelle parvient la loi en empêchant des actes extérieurs, quant à ces maux qui peuvent perturber l’état pacifique de la cité. Or la finalité de la loi divine est de conduire l’homme à la finalité de la félicité éternelle ; laquelle fin est empêchée par quelque péché que ce soit, et non pas seulement par des actes extérieurs, mais aussi par des actes intérieurs. |
ST, I-II, q. 94, a. 2, Resp.:
| Tertio modo inest homini inclinatio ad bonum secundum naturam rationis, quae est sibi propria, sicut homo habet naturalem inclinationem ad hoc quod veritatem cognoscat de Deo, et ad hoc quod in societate vivat. Et secundum hoc, ad legem naturalem pertinent ea quae ad huiusmodi inclinationem spectant, utpote quod homo ignorantiam vitet, quod alios non offendat cum quibus debet conversari, et cetera huiusmodi quae ad hoc spectant. | En troisième lieu, se trouve en l’homme une inclination vers le bien selon la nature de la raison, qui lui est propre ; ainsi l’homme a-t-il une inclination naturelle à connaître la vérité sur Dieu, ainsi qu’à vivre en société. En ce sens, à la loi naturelle appartient tout ce qui relève d’une inclination de cette sorte : par exemple que l’homme évite l’ignorance, ou n’offense pas les autres hommes avec lesquels il doit vivre, et toutes les autres prescriptions qui relèvent de cela. |
[1] Cf. saint Augustin, Le libre arbitre, I, 5, 11 (trad. G. Madec, « Bibliothèque augustinienne », DDB, Paris 1976, p. 211) : « selon moi, une loi qui ne serait pas juste, ne serait pas une loi » (« lex mihi esse non videtur, quae justa non fuerit »). Cette phrase de saint Augustin explique la phrase précédente, dans laquelle il s’est repris d’avoir employé l’expression de « lois injustes » : il est préférable, plutôt, de parler de lois qui sont « nulles ».
[2] Toutes les traductions sont faites par nos soins.
Atelier / Laboratoire
Un tel exposé ne pouvait que donner lieu à de nombreuses interrogations, rebonds, et prolongations de réflexions. C’est la vocation même de Dignète ! Merci aux contributeurs non filmés .